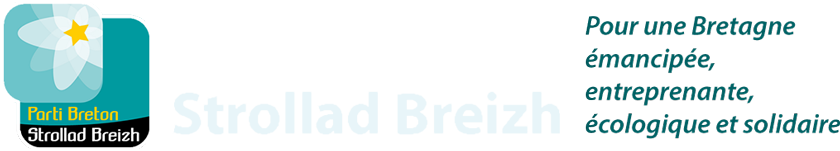Le gouvernement a engagé depuis 2012 une vaste réforme territoriale dont on a encore du mal à concevoir ce qu’elle produira. Le renforcement des métropoles et la régionalisation promise vont-ils modifier en profondeur notre organisation territoriale ?
Le gouvernement a engagé depuis 2012 une vaste réforme territoriale dont on a encore du mal à concevoir ce qu’elle produira. Le renforcement des métropoles et la régionalisation promise vont-ils modifier en profondeur notre organisation territoriale ?
Je crains que non. Cela ressemble, hélas, à une réformette de plus. Les points noirs de notre organisation territoriale ne sont pas traités par les différents projets de loi. Le fond est contestable, mais la méthode aussi. Car sur les régions, l’exécutif a commencé par redessiner la carte qui ne posait pas de problème, alors que la priorité était de revoir l’articulation entre les départements et les régions. Les élus ont dépensé beaucoup d’énergie à s’entredéchirer sur la carte, alors que l’essentiel, c’est le développement des territoires et la capacité politique à agir. Car il y a bien une nouvelle géographie des territoires qui se construit avec la mondialisation et elle n’épouse pas vraiment cette carte des grandes régions.
La première loi, celle sur les métropoles, marque, elle, un vrai tournant…
Oui, et c’est bien ce qui m’inquiète. Autant la loi sur les compétences des régions sera une “petite loi”, autant la loi Maptam [loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ndlr] de janvier 2014 consacre des métropoles puissantes qui vont agir sans contre-pouvoir. Les départements sont affaiblis suite aux annonces et revirements de ces derniers mois. De leur côté, les régions vont voir leurs compétences élargies, mais sans outil juridique et financier pour faire face aux défis.
Quels peuvent être les contre-pouvoirs face aux métropoles ?
Lorsque l’on a des métropoles ou des aires urbaines puissantes, il faut nécessairement, en face, des contre-pouvoirs pour assurer la péréquation, éviter l’aspiration des richesses, de la main-d’œuvre qualifiée. Regardons la situation dans les autres démocraties occidentales : la seule façon de contrebalancer des gouvernements métropolitains puissants, c’est d’avoir des gouvernements régionaux forts. C’est le modèle fédéral. Car il faut une capacité financière et normative pour assurer les péréquations en termes de politiques publiques. Sur ce plan, la loi NOTRe [loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ndlr] passe complètement à côté.
Finalement, le vrai contre-pouvoir face aux métropoles, c’est l’État et ses services déconcentrés !
Avec la mise en œuvre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), la figure du préfet de région a été renforcée mais, dans le même temps, ses services se sont affaissés, tous les élus locaux l’ont constaté. Trouver une compétence technique sur des sujets d’interprétation réglementaire ou de la loi est difficile dans certaines régions et départements car ce savoir-faire a disparu, faute de personnel remplacé.
L’État est-il en capacité de retrouver ces compétences et est-ce souhaitable ?
Nous sommes à la croisée des chemins. Or cette réforme territoriale permet de continuer de tout faire : on régionalise un peu, mais on garde finalement les départements. Bien sûr, l’État déconcentré demeure, tout en étant affaibli. Les seuls que la réforme renforce, ce sont les gouvernements métropolitains. Pourquoi pas, mais cela ne suffit pas pour construire un vrai récit modernisateur sur l’organisation territoriale de la République. Et j’ajoute que ce système est anxiogène pour une partie non négligeable du territoire.
Vous déplorez une régionalisation insuffisante, mais les “grandes” régions vont quand même peser face aux métropoles et face à l’État…
Certes, l’idée régionale est renforcée, mais il y a toujours ce grand fantasme technocratique français de créer de grandes régions autour de grandes villes. Cela a commencé dans les années 1930, puis dans les années 1950 et 1960. Et d’une certaine manière, on continue en 2015. On est le seul pays du monde à réinventer notre organisation administrative par les cartes. Or ce qui fait la puissance, ce sont les compétences juridiques et financières. On a donc une régionalisation incomplète. Le risque avec les grandes régions est de constituer des colosses aux pieds d’argile. Avec des territoires géographiques trop importants dans certains cas, on ressuscite les départements. Par exemple, dans la nouvelle région qui regroupe l’Aquitaine, Poitou-Charentes et le Limousin, les conseils départementaux auront toute légitimité à agir car ils incarneront la proximité. Quant à l’idée de faire des économies en regroupant les régions, je vous laisse imaginer les dépenses de communication qu’elles vont générer pour exister et se faire connaître du public…
Comment expliquez-vous que l’exécutif se soit engagé dans une telle voie ?
C’est une erreur sans doute liée à un déficit de réflexion sur l’organisation territoriale. C’est dommage car la France avait une occasion unique de réussir une grande réforme. Or cela va se terminer comme en 2004, lorsque le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin voulait pousser les régions. Bilan des courses : 8 milliards d’euros sur 12 transférés aux départements. Avec l’actuelle réforme, c’est un peu la même chose car le lobbying départementaliste reste très fort au Sénat.
L’idée de fusionner des niveaux de collectivités avec la création d’une collectivité unique, comme cela a failli se faire en Alsace, est-elle bonne ?
On l’a vu en Alsace en 2013, c’est difficile de mobiliser les gens sur ces questions. Il faut pourtant que le législateur facilite le passage aux collectivités uniques en jouant sur des dotations bonifiées. En période de disette budgétaire, ce serait efficace. Mais pour rapprocher les conseils départementaux et le conseil régional, il faut que le périmètre de la région reste à taille humaine. Pour les grandes régions, la solution passe par une “agencification” du conseil départemental, c’est-à-dire le regroupement dans une même agence des services de l’État, des administrations du conseil départemental, de la caisse d’allocations familiales. Bref, la création d’une agence départementale des politiques sociales.
Pilotée par la région ?
Oui, pilotée par le conseil régional ou en tout cas par une collectivité unique. Au passage, on ôte aux élus cette compétence et, d’une certaine manière, on dépolitise le conseil départemental. Je rappelle que 60 % du budget des départements sont des prestations sociales. On n’a pas besoin d’élus pour faire cela, un haut fonctionnaire peut très bien le gérer. Dans les territoires aussi, on a besoin de politiques au bon endroit !
Cela voudrait dire que les services déconcentrés de l’État passeraient aussi sous la houlette de la région…
Après les premières lois de décentralisation [en 1982, ndlr], Gaston Defferre avait regretté de ne pas avoir fait la réforme de la déconcentration. On le voit sur la formation professionnelle, l’emploi, les infrastructures, l’État persiste à vouloir garder des bouts de compétences. Aujourd’hui, les signaux sont contradictoires : on nous dit qu’on va “dévitaliser” les départements et que, pour compenser, on va renforcer les services déconcentrés de l’État alors que ces dernières années, ces services ont précisément été dépeuplés. Où est la logique ?
Pourquoi l’État résiste-t-il donc, a fortiori si son réseau est affaibli ?
Mon point de vue, c’est qu’on hésite à bousculer les clientèles électorales que constituent les fonctionnaires de l’État. On avait déjà vu cela lors du transfert des personnels TOS [techniciens, ouvriers et de service, ndlr] aux collectivités locales il y a dix ans. Sortir du giron de l’État inquiète les agents. Aujourd’hui, on constate par exemple certaines réticences dans les préfectures, chez les agents qui gèrent les fonds européens et qui vont être transférés. Certains ont intérêt à poursuivre une forme de centralisation, parce que cela préserve les avantages acquis de représentativité d’un certain nombre de syndicats. Je perçois une grande difficulté à adopter une conception plus moderne de l’intérêt général. C’est un problème quasi philosophique : comment l’action publique peut être d’intérêt général lorsqu’elle est menée par des collectivités locales. On a encore l’impression que quand on a affaire à des collectivités, ce serait un intérêt particulier.
Les élus locaux ont peut- être une part de responsabilité…
Oui, c’est la faute de certains élus locaux, mais aussi de l’État qui, plutôt que se concentrer sur ses missions essentielles, comme le contrôle de légalité, le contrôle financier, la réforme fiscale pour améliorer la solidarité entre les territoires, continue à entretenir des services déconcentrés de moins en moins efficaces.
Le blocage serait-il donc avant tout culturel ?
On n’assume pas le grand saut et le grand saut sera le fédéralisme à la française. Tout ce qui concerne les politiques non régaliennes, ce sera aux collectivités territoriales, régions et intercommunalités de les assumer. Je suis persuadé que c’est la révolution des vingt ans à venir : la prise en compte du territoire comme une composante naturelle de l’action publique.
L’expérimentation peut-elle aider à faire avancer ces idées ?
Dans les collectivités, le droit à l’expérimentation à la française, c’est un droit à la généralisation. Au bout de cinq ans, si l’expérience a fonctionné dans telle ou telle collectivité, vous êtes obligé de la généraliser. C’est : soit on arrête, soit on continue pour tout le monde, sans distinction ! Pourtant, on pourrait très bien imaginer qu’un territoire choisisse une organisation ad hoc. On doit accepter la différentiation dans les modes d’organisation. Le législateur l’a d’ailleurs accepté pour les métropoles. La Loi Maptam est une première grande loi de différenciation territoriale, comme l’a montré le cas de Lyon.
Pourquoi n’a-t-on pas tenu compte, dans la nouvelle carte des régions, de la géographie des territoires dessinée par la mondialisation ?
La mondialisation consacre les aires urbaines et métropolitaines qui sont des pôles de croissance. Avec la loi Maptam, le législateur court, en quelque sorte, derrière l’économie. En revanche, comment transformer nos régions en incubateurs d’une économie régionale ? Ce n’est pas une question de carte. Le pays basque espagnol est tout petit, mais c’est l’une des régions les plus dynamiques d’Espagne. Ses compétences sont très larges, son budget plus important que celui de l’Île-de-France.
Avec une dimension politique importante aussi…
Pour réussir la régionalisation, il faut créer un gouvernement régional. Des compétences, de l’argent, oui, mais avec une vie politique régionale. Si vous n’avez pas ce sentiment d’un “vivre-ensemble régional”, ce sera difficile de mobiliser les acteurs autour d’un projet de développement à l’échelle du territoire. Il aurait fallu consolider les gouvernements régionaux en instaurant un parlementarisme régional, dissocier enfin la fonction exécutive et législative. Comme en Corse ou en outre-mer. Là où il y a une vraie vie politique et citoyenne, on débat de l’avenir d’un territoire.
Cela ne revient-il pas à ranimer la flamme identitaire dans les régions ?
L’identité d’un territoire, d’une région fait un peu peur, alors je préfère parler de vivre-ensemble. Favoriser, là où c’est possible, les projets de territoires qui reposent sur un sentiment d’appartenance. Des territoires qui ont envie de se projeter dans la mondialisation et l’intégration européenne et qui ne sont pas dans l’attente passive de politiques ministérielles. Pourquoi la Vendée marche-t-elle bien, au point qu’on pourrait fusionner sans problème les compétences de la région et du département ? Parce qu’il y a une convergence d’intérêts entre les forces économiques, sociales et politiques. Cela peut marcher aussi pour la Bretagne, la Normandie. Mais on ne le fait pas car cela heurte le récit républicain traditionnel. Du coup, on risque de handicaper certaines régions, comme l’Alsace ou l’Aquitaine. Il y a un risque de casser des dynamiques régionales qui se sont bâties dans la durée. De ce point de vue, la réforme est ratée.
Vous évoquiez les transferts de fonctionnaires. Notre organisation de la fonction publique est-elle aujourd’hui un frein à la réforme territoriale ?
Avoir une fonction publique unique faciliterait évidemment les passerelles car ce qui bloque, ce sont les statuts. Plus on multiplie les statuts, plus on rigidifie le cadre de la réforme, c’est une leçon classique de la sociologie des organisations. Une réforme de la fonction publique serait un facilitateur en ce qui concerne la gestion du personnel car quand on parle de réforme territoriale, le volet ressources humaines est peu abordé. Aucun accompagnement de la réforme n’est vraiment prévu. C’est symptomatique du mal français de ne pas savoir réformer, à l’exception de quelques rares périodes historiques. Le consensus à l’allemande, où l’on négocie durant trois mois avant d’avoir un gouvernement, le temps de se mettre d’accord sur un mémorandum de réforme pour ensuite l’appliquer, c’est hors de notre culture. Notre culture, c’est : je suis le chef, j’ai décidé que… En réalité, le contexte fait qu’il est de plus en plus difficile de réformer dans un cadre de monarchie républicaine. On concentre tous les pouvoirs, mais aussi toutes les attaques venues des corporatismes.
Cette réforme territoriale que vous estimez loupée handicape-t-elle la France par rapport à ses partenaires européens ?
C’est handicapant en termes d’image. Aujourd’hui, la seule réforme menée, c’est la réduction des déficits. Et le seul volet de la réforme territoriale qui porte ses fruits, c’est la baisse des dotations de l’État aux collectivités locales. Le problème est que, là encore, c’est anxiogène car ce sont des baisses de dotations sans projet, sans récit modernisateur.
Cette baisse des dotations va contraindre les collectivités à bouger, à se réformer…
Oui, mais cela ne suffit pas. La France renvoie encore l’image d’un pays qui a des difficultés à envisager des réformes de grande envergure. Le monde bouge, les questions d’innovation, d’enseignement supérieur, ce n’est pas l’État qui est en mesure de les gérer. Il faut faire confiance à la société, aux chefs d’entreprise, aux chercheurs. Mais pour réussir cette mutation, il faudrait un cadre d’évolution plus musclé, plus transparent, plus responsable, et la réforme territoriale ne s’engage pas dans cette voie. Je vous rappelle qu’on a quand même annoncé la fin des départements pour y renoncer six mois plus tard, c’est invraisemblable ! Une réforme territoriale qui valoriserait le rôle des citoyens, avec une responsabilité politique éclaircie, cela donnerait une France confiante, réconciliée sur ses valeurs. Le problème est qu’on proclame de belles valeurs, mais que le fil se tend chaque jour entre ces principes et la réalité, comme on le constate, par exemple, sur la question de l’égalité des territoires.
Cette réforme sera-t- elle la prochaine ?
On y reviendra forcément. Les séquences se rapprochent. On a eu 2003-2004 avec l’acte II de la décentralisation, qui a loupé sa cible. En 2010, la droite a créé le conseiller territorial, qui a été abrogé en 2012. On a une nouvelle séquence depuis deux ans et on n’a toujours pas sauté le pas…
Peut-être parce que le pays n’est pas mûr pour sauter le pas et que les gens ont tendance à se tourner vers l’État…
Pour faire un projet, il faut une communauté, partager des choses. Oui, l’État est le grand arbitre, c’est notre modèle français. Diviser pour mieux régner et l’État se situe au-dessus, en majesté… Mais le contexte économique, social, politique a beaucoup changé. Dans la gouvernance soft qu’est l’économie, nous avons besoin d’une réactivité que n’ont pas les services de l’État. La verticalité de l’action publique a été conçue pour organiser des fonctions régaliennes. Pour le non-régalien, la gestion du développement économique, de la cohésion sociale, le vivre-ensemble, on doit décentraliser pour davantage responsabiliser les citoyens. Et on le sait depuis Lionel Jospin il y a quinze ans, l’État ne peut plus tout !
Faut-il réformer nos institutions ?
Il faut que notre organisation institutionnelle suscite davantage une prise de conscience collective dans les territoires. Cela suppose de changer le logiciel de notre démocratie. À côté de la démocratie représentative, on doit se doter d’une série d’outils pour changer cette culture politique citoyenne descendante, à travers des jurys citoyens, des référendums locaux, un droit de pétition, etc.
Les élus locaux ont adopté cette verticalité de l’action publique. Faut-il donc aussi réformer notre démocratie locale ?
La monarchie républicaine s’est déclinée à tous les niveaux. Comment est-il possible de maintenir des élus qui ont, à la fois, des fonctions exécutives et législatives ? Où sont les contre-pouvoirs ? Il faut donc organiser différemment la démocratie locale. Les décisions seront peut être plus longues à prendre, mais elles seront plus acceptables car ce qui nous manque aujourd’hui, c’est l’adhésion sociale autour de la décision publique. L’essentiel est de casser cette verticalité de l’action publique car elle produit beaucoup de frustration, du rejet et suscite des radicalités politiques. Si nous ne sommes pas capables, à l’échelle locale et régionale, de transformer notre façon de produire l’action publique en y injectant plus de participation citoyenne, on va au-devant de gros soucis.
Propos recueillis par Bruno Botella et Sylvain Henry
Le gouvernement a engagé depuis 2012 une vaste réforme territoriale dont on a encore du mal à concevoir ce qu’elle produira. Le renforcement des métropoles et la régionalisation promise vont-ils modifier en profondeur notre organisation territoriale ?
Je crains que non. Cela ressemble, hélas, à une réformette de plus. Les points noirs de notre organisation territoriale ne sont pas traités par les différents projets de loi. Le fond est contestable, mais la méthode aussi. Car sur les régions, l’exécutif a commencé par redessiner la carte qui ne posait pas de problème, alors que la priorité était de revoir l’articulation entre les départements et les régions. Les élus ont dépensé beaucoup d’énergie à s’entredéchirer sur la carte, alors que l’essentiel, c’est le développement des territoires et la capacité politique à agir. Car il y a bien une nouvelle géographie des territoires qui se construit avec la mondialisation et elle n’épouse pas vraiment cette carte des grandes régions.
La première loi, celle sur les métropoles, marque, elle, un vrai tournant…
Oui, et c’est bien ce qui m’inquiète. Autant la loi sur les compétences des régions sera une “petite loi”, autant la loi Maptam [loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ndlr] de janvier 2014 consacre des métropoles puissantes qui vont agir sans contre-pouvoir. Les départements sont affaiblis suite aux annonces et revirements de ces derniers mois. De leur côté, les régions vont voir leurs compétences élargies, mais sans outil juridique et financier pour faire face aux défis.
Quels peuvent être les contre-pouvoirs face aux métropoles ?
Lorsque l’on a des métropoles ou des aires urbaines puissantes, il faut nécessairement, en face, des contre-pouvoirs pour assurer la péréquation, éviter l’aspiration des richesses, de la main-d’œuvre qualifiée. Regardons la situation dans les autres démocraties occidentales : la seule façon de contrebalancer des gouvernements métropolitains puissants, c’est d’avoir des gouvernements régionaux forts. C’est le modèle fédéral. Car il faut une capacité financière et normative pour assurer les péréquations en termes de politiques publiques. Sur ce plan, la loi NOTRe [loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ndlr] passe complètement à côté.
Finalement, le vrai contre-pouvoir face aux métropoles, c’est l’État et ses services déconcentrés !
Avec la mise en œuvre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), la figure du préfet de région a été renforcée mais, dans le même temps, ses services se sont affaissés, tous les élus locaux l’ont constaté. Trouver une compétence technique sur des sujets d’interprétation réglementaire ou de la loi est difficile dans certaines régions et départements car ce savoir-faire a disparu, faute de personnel remplacé.
L’État est-il en capacité de retrouver ces compétences et est-ce souhaitable ?
Nous sommes à la croisée des chemins. Or cette réforme territoriale permet de continuer de tout faire : on régionalise un peu, mais on garde finalement les départements. Bien sûr, l’État déconcentré demeure, tout en étant affaibli. Les seuls que la réforme renforce, ce sont les gouvernements métropolitains. Pourquoi pas, mais cela ne suffit pas pour construire un vrai récit modernisateur sur l’organisation territoriale de la République. Et j’ajoute que ce système est anxiogène pour une partie non négligeable du territoire.
Vous déplorez une régionalisation insuffisante, mais les “grandes” régions vont quand même peser face aux métropoles et face à l’État…
Certes, l’idée régionale est renforcée, mais il y a toujours ce grand fantasme technocratique français de créer de grandes régions autour de grandes villes. Cela a commencé dans les années 1930, puis dans les années 1950 et 1960. Et d’une certaine manière, on continue en 2015. On est le seul pays du monde à réinventer notre organisation administrative par les cartes. Or ce qui fait la puissance, ce sont les compétences juridiques et financières. On a donc une régionalisation incomplète. Le risque avec les grandes régions est de constituer des colosses aux pieds d’argile. Avec des territoires géographiques trop importants dans certains cas, on ressuscite les départements. Par exemple, dans la nouvelle région qui regroupe l’Aquitaine, Poitou-Charentes et le Limousin, les conseils départementaux auront toute légitimité à agir car ils incarneront la proximité. Quant à l’idée de faire des économies en regroupant les régions, je vous laisse imaginer les dépenses de communication qu’elles vont générer pour exister et se faire connaître du public…
Comment expliquez-vous que l’exécutif se soit engagé dans une telle voie ?
C’est une erreur sans doute liée à un déficit de réflexion sur l’organisation territoriale. C’est dommage car la France avait une occasion unique de réussir une grande réforme. Or cela va se terminer comme en 2004, lorsque le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin voulait pousser les régions. Bilan des courses : 8 milliards d’euros sur 12 transférés aux départements. Avec l’actuelle réforme, c’est un peu la même chose car le lobbying départementaliste reste très fort au Sénat.
L’idée de fusionner des niveaux de collectivités avec la création d’une collectivité unique, comme cela a failli se faire en Alsace, est-elle bonne ?
On l’a vu en Alsace en 2013, c’est difficile de mobiliser les gens sur ces questions. Il faut pourtant que le législateur facilite le passage aux collectivités uniques en jouant sur des dotations bonifiées. En période de disette budgétaire, ce serait efficace. Mais pour rapprocher les conseils départementaux et le conseil régional, il faut que le périmètre de la région reste à taille humaine. Pour les grandes régions, la solution passe par une “agencification” du conseil départemental, c’est-à-dire le regroupement dans une même agence des services de l’État, des administrations du conseil départemental, de la caisse d’allocations familiales. Bref, la création d’une agence départementale des politiques sociales.
Pilotée par la région ?
Oui, pilotée par le conseil régional ou en tout cas par une collectivité unique. Au passage, on ôte aux élus cette compétence et, d’une certaine manière, on dépolitise le conseil départemental. Je rappelle que 60 % du budget des départements sont des prestations sociales. On n’a pas besoin d’élus pour faire cela, un haut fonctionnaire peut très bien le gérer. Dans les territoires aussi, on a besoin de politiques au bon endroit !
Cela voudrait dire que les services déconcentrés de l’État passeraient aussi sous la houlette de la région…
Après les premières lois de décentralisation [en 1982, ndlr], Gaston Defferre avait regretté de ne pas avoir fait la réforme de la déconcentration. On le voit sur la formation professionnelle, l’emploi, les infrastructures, l’État persiste à vouloir garder des bouts de compétences. Aujourd’hui, les signaux sont contradictoires : on nous dit qu’on va “dévitaliser” les départements et que, pour compenser, on va renforcer les services déconcentrés de l’État alors que ces dernières années, ces services ont précisément été dépeuplés. Où est la logique ?
Pourquoi l’État résiste-t-il donc, a fortiori si son réseau est affaibli ?
Mon point de vue, c’est qu’on hésite à bousculer les clientèles électorales que constituent les fonctionnaires de l’État. On avait déjà vu cela lors du transfert des personnels TOS [techniciens, ouvriers et de service, ndlr] aux collectivités locales il y a dix ans. Sortir du giron de l’État inquiète les agents. Aujourd’hui, on constate par exemple certaines réticences dans les préfectures, chez les agents qui gèrent les fonds européens et qui vont être transférés. Certains ont intérêt à poursuivre une forme de centralisation, parce que cela préserve les avantages acquis de représentativité d’un certain nombre de syndicats. Je perçois une grande difficulté à adopter une conception plus moderne de l’intérêt général. C’est un problème quasi philosophique : comment l’action publique peut être d’intérêt général lorsqu’elle est menée par des collectivités locales. On a encore l’impression que quand on a affaire à des collectivités, ce serait un intérêt particulier.
Les élus locaux ont peut-être une part de responsabilité…
Oui, c’est la faute de certains élus locaux, mais aussi de l’État qui, plutôt que se concentrer sur ses missions essentielles, comme le contrôle de légalité, le contrôle financier, la réforme fiscale pour améliorer la solidarité entre les territoires, continue à entretenir des services déconcentrés de moins en moins efficaces.
Le blocage serait-il donc avant tout culturel ?
On n’assume pas le grand saut et le grand saut sera le fédéralisme à la française. Tout ce qui concerne les politiques non régaliennes, ce sera aux collectivités territoriales, régions et intercommunalités de les assumer. Je suis persuadé que c’est la révolution des vingt ans à venir : la prise en compte du territoire comme une composante naturelle de l’action publique.
L’expérimentation peut-elle aider à faire avancer ces idées ?
Dans les collectivités, le droit à l’expérimentation à la française, c’est un droit à la généralisation. Au bout de cinq ans, si l’expérience a fonctionné dans telle ou telle collectivité, vous êtes obligé de la généraliser. C’est : soit on arrête, soit on continue pour tout le monde, sans distinction ! Pourtant, on pourrait très bien imaginer qu’un territoire choisisse une organisation ad hoc. On doit accepter la différentiation dans les modes d’organisation. Le législateur l’a d’ailleurs accepté pour les métropoles. La Loi Maptam est une première grande loi de différenciation territoriale, comme l’a montré le cas de Lyon.
Pourquoi n’a-t-on pas tenu compte, dans la nouvelle carte des régions, de la géographie des territoires dessinée par la mondialisation ?
La mondialisation consacre les aires urbaines et métropolitaines qui sont des pôles de croissance. Avec la loi Maptam, le législateur court, en quelque sorte, derrière l’économie. En revanche, comment transformer nos régions en incubateurs d’une économie régionale ? Ce n’est pas une question de carte. Le pays basque espagnol est tout petit, mais c’est l’une des régions les plus dynamiques d’Espagne. Ses compétences sont très larges, son budget plus important que celui de l’Île-de-France.
Avec une dimension politique importante aussi…
Pour réussir la régionalisation, il faut créer un gouvernement régional. Des compétences, de l’argent, oui, mais avec une vie politique régionale. Si vous n’avez pas ce sentiment d’un “vivre-ensemble régional”, ce sera difficile de mobiliser les acteurs autour d’un projet de développement à l’échelle du territoire. Il aurait fallu consolider les gouvernements régionaux en instaurant un parlementarisme régional, dissocier enfin la fonction exécutive et législative. Comme en Corse ou en outre-mer. Là où il y a une vraie vie politique et citoyenne, on débat de l’avenir d’un territoire.
Cela ne revient-il pas à ranimer la flamme identitaire dans les régions ?
L’identité d’un territoire, d’une région fait un peu peur, alors je préfère parler de vivre-ensemble. Favoriser, là où c’est possible, les projets de territoires qui reposent sur un sentiment d’appartenance. Des territoires qui ont envie de se projeter dans la mondialisation et l’intégration européenne et qui ne sont pas dans l’attente passive de politiques ministérielles. Pourquoi la Vendée marche-t-elle bien, au point qu’on pourrait fusionner sans problème les compétences de la région et du département ? Parce qu’il y a une convergence d’intérêts entre les forces économiques, sociales et politiques. Cela peut marcher aussi pour la Bretagne, la Normandie. Mais on ne le fait pas car cela heurte le récit républicain traditionnel. Du coup, on risque de handicaper certaines régions, comme l’Alsace ou l’Aquitaine. Il y a un risque de casser des dynamiques régionales qui se sont bâties dans la durée. De ce point de vue, la réforme est ratée.
Vous évoquiez les transferts de fonctionnaires. Notre organisation de la fonction publique est-elle aujourd’hui un frein à la réforme territoriale ?
Avoir une fonction publique unique faciliterait évidemment les passerelles car ce qui bloque, ce sont les statuts. Plus on multiplie les statuts, plus on rigidifie le cadre de la réforme, c’est une leçon classique de la sociologie des organisations. Une réforme de la fonction publique serait un facilitateur en ce qui concerne la gestion du personnel car quand on parle de réforme territoriale, le volet ressources humaines est peu abordé. Aucun accompagnement de la réforme n’est vraiment prévu. C’est symptomatique du mal français de ne pas savoir réformer, à l’exception de quelques rares périodes historiques. Le consensus à l’allemande, où l’on négocie durant trois mois avant d’avoir un gouvernement, le temps de se mettre d’accord sur un mémorandum de réforme pour ensuite l’appliquer, c’est hors de notre culture. Notre culture, c’est : je suis le chef, j’ai décidé que… En réalité, le contexte fait qu’il est de plus en plus difficile de réformer dans un cadre de monarchie républicaine. On concentre tous les pouvoirs, mais aussi toutes les attaques venues des corporatismes.
Cette réforme territoriale que vous estimez loupée handicape-t-elle la France par rapport à ses partenaires européens ?
C’est handicapant en termes d’image. Aujourd’hui, la seule réforme menée, c’est la réduction des déficits. Et le seul volet de la réforme territoriale qui porte ses fruits, c’est la baisse des dotations de l’État aux collectivités locales. Le problème est que, là encore, c’est anxiogène car ce sont des baisses de dotations sans projet, sans récit modernisateur.
Cette baisse des dotations va contraindre les collectivités à bouger, à se réformer…
Oui, mais cela ne suffit pas. La France renvoie encore l’image d’un pays qui a des difficultés à envisager des réformes de grande envergure. Le monde bouge, les questions d’innovation, d’enseignement supérieur, ce n’est pas l’État qui est en mesure de les gérer. Il faut faire confiance à la société, aux chefs d’entreprise, aux chercheurs. Mais pour réussir cette mutation, il faudrait un cadre d’évolution plus musclé, plus transparent, plus responsable, et la réforme territoriale ne s’engage pas dans cette voie. Je vous rappelle qu’on a quand même annoncé la fin des départements pour y renoncer six mois plus tard, c’est invraisemblable ! Une réforme territoriale qui valoriserait le rôle des citoyens, avec une responsabilité politique éclaircie, cela donnerait une France confiante, réconciliée sur ses valeurs. Le problème est qu’on proclame de belles valeurs, mais que le fil se tend chaque jour entre ces principes et la réalité, comme on le constate, par exemple, sur la question de l’égalité des territoires.
Cette réforme sera-t- elle la prochaine ?
On y reviendra forcément. Les séquences se rapprochent. On a eu 2003-2004 avec l’acte II de la décentralisation, qui a loupé sa cible. En 2010, la droite a créé le conseiller territorial, qui a été abrogé en 2012. On a une nouvelle séquence depuis deux ans et on n’a toujours pas sauté le pas…
Peut-être parce que le pays n’est pas mûr pour sauter le pas et que les gens ont tendance à se tourner vers l’État…
Pour faire un projet, il faut une communauté, partager des choses. Oui, l’État est le grand arbitre, c’est notre modèle français. Diviser pour mieux régner et l’État se situe au-dessus, en majesté… Mais le contexte économique, social, politique a beaucoup changé. Dans la gouvernance soft qu’est l’économie, nous avons besoin d’une réactivité que n’ont pas les services de l’État. La verticalité de l’action publique a été conçue pour organiser des fonctions régaliennes. Pour le non-régalien, la gestion du développement économique, de la cohésion sociale, le vivre-ensemble, on doit décentraliser pour davantage responsabiliser les citoyens. Et on le sait depuis Lionel Jospin il y a quinze ans, l’État ne peut plus tout !
Faut-il réformer nos institutions ?
Il faut que notre organisation institutionnelle suscite davantage une prise de conscience collective dans les territoires. Cela suppose de changer le logiciel de notre démocratie. À côté de la démocratie représentative, on doit se doter d’une série d’outils pour changer cette culture politique citoyenne descendante, à travers des jurys citoyens, des référendums locaux, un droit de pétition, etc.
Les élus locaux ont adopté cette verticalité de l’action publique. Faut-il donc aussi réformer notre démocratie locale ?
La monarchie républicaine s’est déclinée à tous les niveaux. Comment est-il possible de maintenir des élus qui ont, à la fois, des fonctions exécutives et législatives ? Où sont les contre-pouvoirs ? Il faut donc organiser différemment la démocratie locale. Les décisions seront peut être plus longues à prendre, mais elles seront plus acceptables car ce qui nous manque aujourd’hui, c’est l’adhésion sociale autour de la décision publique. L’essentiel est de casser cette verticalité de l’action publique car elle produit beaucoup de frustration, du rejet et suscite des radicalités politiques. Si nous ne sommes pas capables, à l’échelle locale et régionale, de transformer notre façon de produire l’action publique en y injectant plus de participation citoyenne, on va au-devant de gros soucis.
Propos recueillis par Bruno Botella et Sylvain Henry
Parcours
1994 Diplômé de Sciences-Po Rennes
2000 Doctorat en science politique et chercheur “Jean Monnet” à l’Institut universitaire européen de Florence
2002 Recruté au CNRS
2012 Publication de Le pouvoir régional, mobilisations, décentralisation et gouvernance en France Paris, Presses de Sciences-Po
2014 Publication de Réussir la région au service du citoyen, de la croissance et de la République, Paris, Institut de la gouvernance territoriale
2015 Création de la chaire “Territoires et mutations de l’action publique” à Sciences-Po Rennes